Règne des Animaux
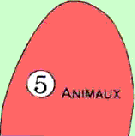
Règne des Animaux
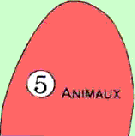
Embranchement des Spongiaires (Porifères)
pas de symétrie, pas d’organes définis, cellules à collerette
(choanocytes)
4 classes
18 ordre
80 familles
10000 espèces
|
Classes |
Ordres |
Genre espèce |
Nom commun |
|
Démosponges |
Monactinellides |
|
|
|
Tétractinellides |
|
|
|
|
Lithistides |
Chenendopora |
|
|
|
Sclérosponges |
Spongia |
|
|
|
Calcisponges |
Chaetetides |
Leucettusa
lancifer |
|
|
Hexactinellides |
Amphidiscophores |
Monoraphis |
|
|
Hexasténophores |
Euplectelles |
1) Organisation :
Les spongiaires, ou éponges, sont des animaux aquatiques essentiellement marins
(environ 9000 espèces), isolés ou coloniaux, n'ayant pas d'organes différenciés.
L'organisation générale de cet organisme diploblastique est rudimentaire : il
s'agit d'une sorte de sac dans lequel circule l'eau de mer.
 La
circulation de l'eau se fait à sens unique par un pore exhalant, ou oscule, et
des pores exhalant, ou ostioles. Les choanocytes (voir plus loin) assurent les
mouvements de l'eau par des battements de flagelles.
La
circulation de l'eau se fait à sens unique par un pore exhalant, ou oscule, et
des pores exhalant, ou ostioles. Les choanocytes (voir plus loin) assurent les
mouvements de l'eau par des battements de flagelles.
La paroi est constituée des deux feuillets embryonnaires légèrement différenciés
: l'ectoblaste avec des pinacocytes (cellules en plaques) et l'endoblaste avec
des choanocytes (cellules flagellées). Entre les deux se forme un faux tissu
appelé mésoglée, sorte de gelée riche en fibres de collagène.
La cavité centrale est appelée cavité gastrale, atrium ou encore spongocoele.
 Une coupe
détaillée de la paroi permet de voir les différents types de cellules citées
précédemment ainsi que d'autres dont le rôle n'est pas moindre : les collencytes
qui consolident la mésoglée, les amibocytes qui peuvent engendrer tous les
autres types de cellules (faculté de régénération de l'éponge), les porocytes
qui délimitent les canaux dans la paroi et les sclérocytes qui fabriquent une
charpente très primitive consituées de baguettes à une ou plusieurs branches
souvent calcaires, les spicules.
Une coupe
détaillée de la paroi permet de voir les différents types de cellules citées
précédemment ainsi que d'autres dont le rôle n'est pas moindre : les collencytes
qui consolident la mésoglée, les amibocytes qui peuvent engendrer tous les
autres types de cellules (faculté de régénération de l'éponge), les porocytes
qui délimitent les canaux dans la paroi et les sclérocytes qui fabriquent une
charpente très primitive consituées de baguettes à une ou plusieurs branches
souvent calcaires, les spicules.
La classification des spongiaires repose essentiellement sur la nature des
spicules (calcaires ou siliceux, nombre de branches).
Cette organisation est la plus simple. Elle
correspond au premier stade de développement de toutes les éponges, le stade
ascon. Certaines éponges ont un développement plus complexe pour conduire au
stade sycon ou leucon.

2) Nutrition
:
Ce sont les choanocytes qui permettent à l'éponge de se nourrir. En effet, ces
cellules ont la capacité de phagocyter (absorber en repliant la membrane de la
cellule) les particules en suspension dans l'eau. Les petites vésicules ainsi
formées (phagosomes) sont transmises vers les amibocytes qui les digèrent.
3) Reproduction :
- reproduction asexuée par bourgeonnement externe
Il s'agit de la formation de petites sphères constituées
de cellules indifférenciées (archéocytes), entourées de pinacocytes, à
l'extrémité de grands spicules radiaires.
- reproduction asexuée par
bourgeonnement interne
C'est un peu le même principe mais à l'intérieur de la mésoglée. On
observe alors de petites sphères enveloppées de spongine que l'on appellent
gemmules. Ce sont des formes de résistance aux conditions défavorables du
milieu.
- reproduction sexuée
Les éponges calcaires sont gonochoriques (sexes séparés) et les éponges
siliceuses sont hermaphrodites (organisme à la fois mâle et femelle). On observe
la présence de spermatozoïdes flagellés et d'ovocytes formés par spermatogenèse
et ovogenèse. La fécondation peut avoir lieue dans l'eau de mer (émission des
gamètes) ou dans l'éponge (incubation).
La larve planctonique ciliée qui se forme est de type parenchymula (pleine) ou
amphiblastula (creuse).